Comme unique conseil à un apprenti romancier, Simenon prodiguait celui de passer, comme il le fit lui-même (de 1919 à 1922), quelques années dans un journal, local de préférence afin d’avoir l’occasion d’y mettre la main à tous les domaines, d’observer tous les milieux et de pratiquer tous les genres [1]. Ainsi l’actualité de l’époque où vécut l’écrivain a-t-elle imprégné son œuvre, bien au-delà des abondants écrits autobiographiques pour lesquels le constat va de soi. La fiction n’exclut pas une dose d’historicité, si pas dans la relation d’événements comme tels, du moins dans le reflet qui nous est livré de l’esprit d’un temps. La publication des actes d’un colloque tenu en 2023, sous la direction de Jean-Louis Dumortier (Université de Liège), permet de glaner maints éléments apportant confirmation ou ouvrant des pistes à cet égard [2].
Du journalisme, le père du commissaire Maigret a certes hérité le style dépouillé, la simplicité délibérée, la non-recherche de l’effet, qui finirent par constituer sa marque de fabrique et lui valurent de nombreux émules. « Pour plus d’un écrivain actuel, souligne le professeur Dumortier, l’usage de la langue caractéristique de Simenon – pas d’acrobaties syntaxiques, pas de coquetteries lexicales, rareté et sobriété des images, absence d’allusions culturelles élitistes, abondance de la ponctuation, multiplication des paragraphes, etc. – est (devenu) un modèle » (p. 10). On songe à l’instruction célèbre donnée à la rédaction de L’Aurore par son patron Georges Clémenceau: « Une phrase se compose d’un sujet, d’un verbe et d’un complément. Ceux qui voudront user d’un adjectif passeront me voir dans mon bureau. Ceux qui emploieront un adverbe seront foutus à la porte » [3]. Boutade ou pas, le propos est révélateur de ce que fut la presse de la première moitié du XXe siècle, du moins quand elle ambitionnait d’atteindre un public populaire parfois superficiellement alphabétisé. La différence aujourd’hui est qu’une Ernaux, un Houellebecq, un Carrère, une Angot, parmi bien d’autres, revendiquent – ou se font reprocher – « une écriture sans relief littéraire » (p. 27).
Par ailleurs et même s’il a roulé sa bosse sous bien d’autres cieux, Simenon, note Delphine Coppin (Universités de Mons et de Liège), a « décidé d’assumer pleinement son identité belge » (p. 141). Ainsi a-t-il inscrit Le pendu de Saint-Pholien (1931), La maison du canal (1933), Le bourgmestre de Furnes (1939) ou encore Pedigree (1948) en partie ou totalement dans notre pays. Ainsi, en outre, a-t-il parsemé ses textes de belgicismes et d’expressions issues de dialectes flamands. Il se singularise en cela de nombre de ses collègues d’alors, enclins à occulter leur origine pour mieux se fondre dans le macrocosme culturel français.
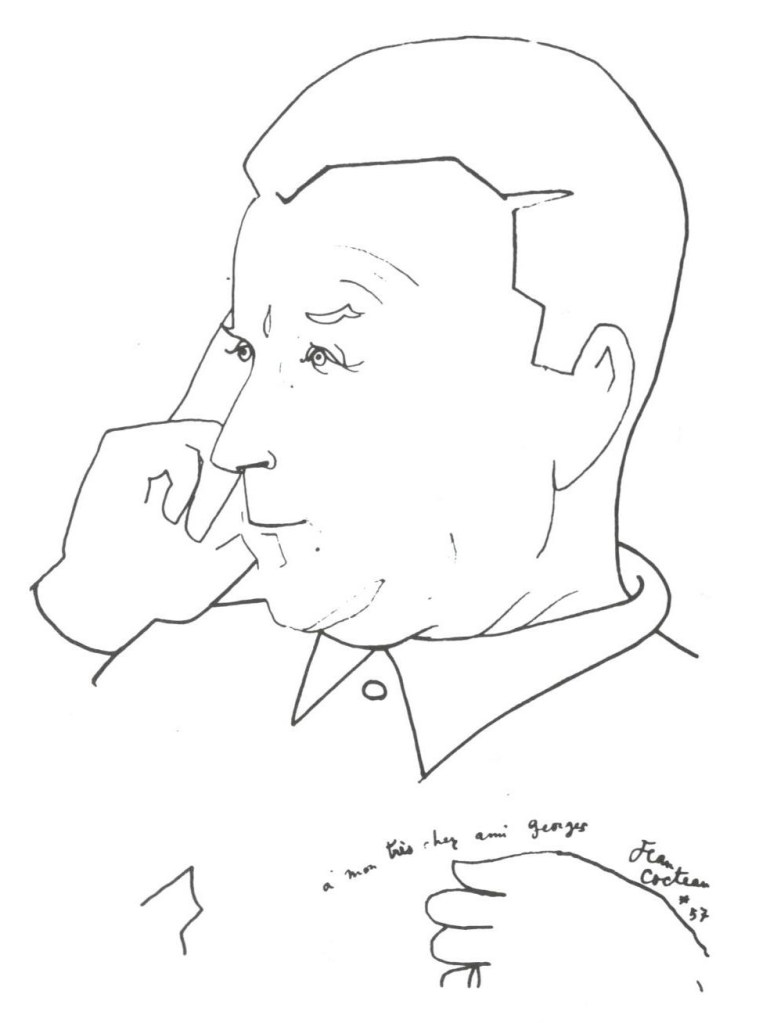
Liège, bien sûr, où naquit l’auteur, occupe – et lui confère – une place de choix. Un parcours Simenon à travers la ville, principalement dans les rues du quartier d’Outremeuse où il a grandi, concrétise ce lien privilégié. Inauguré en 1983, rénové en 2003 et en 2023, il déploie avec les moyens numériques des photographies d’époque, des enregistrements d’extraits, une expérience en réalité augmentée… La Caque, une maison qui fut le lieu de rendez-vous d’un club d’artistes fréquenté par l’écrivain, constitue l’étape par excellence où on peut rendre saillante « la manière dont les textes fictionnels de Simenon absorbaient sa biographie » ou encore « l’irruption possible du vécu d’un auteur dans ses romans » (Alexis Messina & al., pp. 128, 130). La Caque est évoquée dans Les trois crimes de mes amis (1938) ainsi que dans Le pendu de Saint-Pholien, inspiré d’un fait divers que le jeune « Sim » eut à connaître quand il était reporter à la Gazette de Liége.
Chercher dans ses récits les traces d’un engagement serait un peu vain. On peut en revanche, selon les termes de David Vrydaghs (Université de Namur), y trouver le modèle d’une figure attentive « aux victimes de l’Histoire » tout en demeurant « humble et apolitique » (p. 48). Ne faisant pas mystère de sa détestation de la démocratie telle qu’il l’a observée, rappelle Jean-Louis Dumortier, il proclame au fil des pages son attachement aux « petites gens » , aux personnes fragiles, laissées pour compte « d’une ploutocratie qui exalte l’émancipation de l’individu et sa liberté d’entreprendre pour faire de lui le seul responsable d’une situation de détresse » (p. 28). En ce sens, le prosateur francophone le plus traduit après Jules Verne et Alexandre Dumas peut être considéré comme « un pionnier de la littérature du care, de la prise en charge des personnes dans le besoin, de l’assistance aux affligés de toutes sortes » (p. 29).
Plusieurs contributions au colloque traitent des multiples adaptations des écrits simenoniens au cinéma, dans les séries télévisées, dans la bande dessinée et dans la muséographie. Si elles n’ont pas peu contribué à la permanence d’un haut niveau de notoriété et de succès, les enseignements que l’historien peut en tirer ne sont pas toujours manifestes, tant la source initiale subit ici de changements heureux ou non. Entre les romans et les téléfilms, Laurent Demoulin (Université de Liège) a recensé les différences, « une myriade d’infidélités de genres divers » , plus nombreuses et variées qu’il ne l’avait imaginé a priori (pp. 85-103). Ce qui demeure bien souvent est aussi ce qui survit le plus dans la mémoire des lecteurs, à savoir l’ambiance d’un certain univers. C’est elle que monte en épingle la BD Aller-retour de Frédéric Bézian (2012), en s’écartant à dessein des narrations romanesques. Pour Jan Baetens (Katholieke Universiteit Leuven), on s’y trouve immergé dans « le monde fictionnel du romancier – personnages, décors types, situations et atmosphères « récurrentes » » (pp. 112-117). Ce sont là des données, et non des moindres, de la vie quotidienne d’antan.

Quant à Maigret, il synthétise, sans nul doute, ce que furent ses homologues de chair et d’os. Mais force est de constater à quel point, puissamment aidé par Jean Richard et Bruno Cremer, il a vampirisé toute l’œuvre de son créateur à son insu. Marina Geat (Università Roma Tre) relate cette même « cannibalisation » en Italie où les livres étaient publiés avec le visage de l’acteur Gino Cervi (p. 61). Les faits symptomatiques de cette emprise fourmillent. En 1950, par exemple, paraît aux Presses de la cité, sous le titre Maigret et les petits cochons sans queue, un recueil de neuf nouvelles dont deux seulement mettent en scène le commissaire à la pipe. Et ce n’est même pas le cas pour le récit éponyme: il s’intitule Les petits cochons sans queue et nul gradé de police n’y intervient. Mieux encore: le téléfilm adaptant ce récit y convoquera Maigret sans vergogne, avec pour résultat d’en amoindrir la portée. Madame Quatre et ses enfants, provenant du même recueil, subira la même adjonction (pp. 95-97).
Bien peu savent que les Maigret ne constituent qu’une minorité dans l’œuvre fictionnelle de Simenon: 75 récits sur 190, sans parler de la non-fiction. Puisse, pour l’avenir, l’enquêteur du quai des Orfèvres ne plus être l’arbre qui cache la forêt!
P.V.
[1] Jean-Christophe CAMUS, « Sim, reporter à la « Gazette de Liége » », dans Simenon, l’homme, l’univers, la création, Bruxelles, Complexe, 1993, pp. 42-49 (44). – Francis LACASSIN, « Simenon reporter », dans ibid., pp. 66-77 (68). [retour]
[2] Traces, « Simenon. Bilans et perspectives », actes du colloque en l’honneur du 120e anniversaire de la naissance de Georges Simenon, dans le cadre du festival « Le printemps de Simenon », 8-10 mars 2023, n° 28, Liège, Presses universitaires de Liège, 2024, 175 pp. [retour]
[3] Entre autres sur https://www.sophie-colliex.com/post/aimez-vous-les-adjectifs. [retour]
