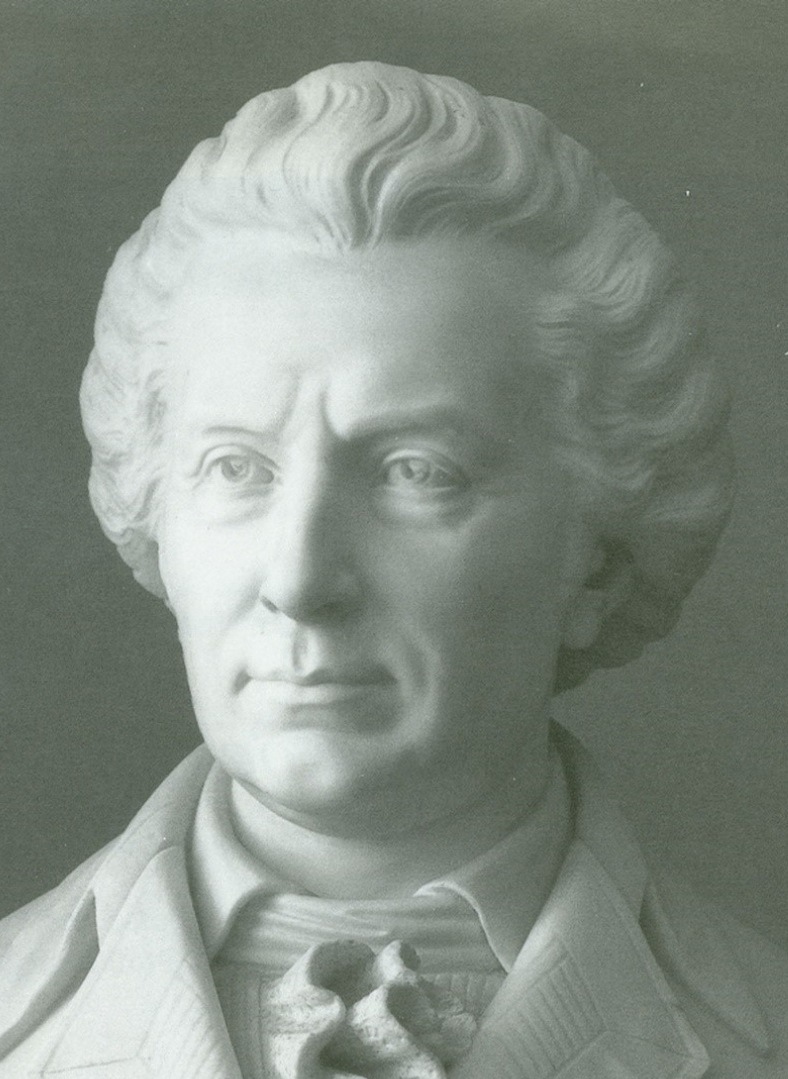La peine de mort a été plus appliquée sous le régime français que sous l’Ancien Régime ou ultérieurement. Dans le département de la Lys, on compte en moyenne une exécution tous les deux mois pendant cette période, en rupture avec l’abolitionnisme de fait qui prévalait dans nos régions depuis le milieu du XVIIIè siècle (1795-1815)
Le 20 octobre 1796, un an après l’annexion de l’espace belge à la France, la guillotine est mise en service pour la première fois sur la Grand-Place de Bruges, chef-lieu du département de la Lys. Les suppliciés sont deux Français, Jean Pigneron et Placide De Lattre, condamnés notamment pour avoir, avec le chef de bande fugitif François Salembier, tué une aubergiste enceinte, grièvement blessé deux autres personnes et volé argent, bijoux et autres biens, dans un établissement situé sur le chemin de Poperinge à Proven.
Le 28 septembre 1813, la dernière peine de mort sous le régime français dans la future province de Flandre-Occidentale est prononcée à l’encontre de Catherine Le Ducq, une bouchère d’Ypres âgée de 25 ans, convaincue d’avoir empoisonné sa sœur cadette à l’arsenic. Après le rejet de son pourvoi en cassation, elle adresse une demande de grâce à… Guillaume Ier, qui ne règne pas encore en Belgique mais y exerce le gouvernement général au nom des puissances alliées. Le recours est rejeté et l’exécution a lieu le 11 octobre 1815.
Entre ces deux dates, toujours dans le même département, 118 hommes et 12 femmes ont été livrés au bourreau par le tribunal criminel, la cour de justice criminelle (à partir de 1804) et la cour d’assises (à partir de 1811), auxquels s’est ajouté le tribunal criminel spécial (sans jury) mis sur pied par Napoléon. Onze de ces déchus du droit à la vie ont échappé au couperet pour des raisons diverses (un suicide, un décès inexpliqué, une évasion, une contumace, deux grâces impériales, cinq cassations). Des 119 autres résulte une moyenne de près de six exécutions par an – ou une par bimestre –, avec deux années particulièrement « fastes » , 1798 (23) et 1803 (27), parce que deux bandes importantes, celle de Salembier déjà citée et celle de Bakelandt, y sont venues grossir les chiffres. Au recensement manquent en revanche les peines prononcées contre des civils par des tribunaux militaires. Des sources mentionnent bien des cas en terres west-flandriennes, mais les archives qui permettraient de les comptabiliser font défaut.
Continuer à lire … « L’âge d’or de la guillotine française »