En 1922 paraissaient, sous le titre Le don du maître, une série de tableaux de la vie scolaire dus à l’écrivain et journaliste Désiré-Joseph Debouck, dit d’Orbaix (1889-1943). L’auteur, également enseignant, avait obtenu des Editions du Monde nouveau, à Paris, qu’elles l’impriment en 500 exemplaires. Ce début modeste ne fut pas de mauvais augure puisque plusieurs rééditions suivirent, jusqu’en 1943. Près de 80 ans plus tard, l’ouvrage revoit le jour par les soins de Renaud Denuit, petit fils de l’homme de lettres, ancien journaliste à la RTBF puis fonctionnaire à la Commission européenne [1].
S’il s’agit bien d’un témoignage et non d’une fiction, compte doit être tenu de son style léché qui, parfois, embrume le factuel. La veine romanesque et surtout poétique qui traverse les autres œuvres de d’Orbaix se retrouve dans son regard sur l’école primaire, à telle enseigne que le liminaire et la fin sont en vers. L’écartèlement entre les deux vocations, la plume ou la craie, s’y exprime d’ailleurs:
« Peut-être bien que Dieu veut pour moi cette gloire
D’un poète écrivant sa pensée et son cœur,
Non dans des vers gravés aux marbres de l’histoire
Mais sur le tableau noir du sous-instituteur! » (p. 25).
Instituteur, son propre père l’avait été lui aussi, dans son village natal de Thorembais-les-Béguines (Perwez). Si Désiré-Joseph, après ses études à l’Ecole normale de Nivelles, exerça pour sa part à Saint-Gilles, dans l’enseignement public, la nostalgie de la campagne ne quitta jamais. Aussi Le don du maître est-il nourri à la fois par son expérience en milieu urbain, de 1908 aux lendemains de la Première Guerre mondiale, et l’expérience paternelle antérieure en milieu rural. Bien accueilli par la critique de l’époque, comme l’illustrent les extraits de presse reproduits en annexes, ce livre est aussi une aubaine pour l’histoire.
Bien qu’un monde nous en sépare aujourd’hui, la classe que décrit l’auteur peut encore, en son temps, paraître immuable. Celle du fils ressemble à celle du père et, à peu de chose près, à celle que les baby-boomers connaîtront encore. Les bancs-pupitres qui portent dans des cases leurs « deux encriers de porcelaine blanche » (p. 65). Le tableau d’où surgissent les dessins, les chiffres et les mots que les élèves « graveront sur leurs ardoises, de leurs crayons de pierre » (p. 53). L’éponge qui sert à nettoyer la planche obscure mais aussi « les visages de bambins » les plus pauvres (p. 57). L’horaire avec ses cases et ses ordres, fixé au mur et dont le papier « fut blanc dans sa jeunesse » (p. 69). Le journal de classe sous sa couverture de moleskine noire, où le magister « prophétise des choses qu’il s’étonne de ne pouvoir accomplir le lendemain » (p. 84)! Les cartes coloriées par lesquelles le samedi, « jour de paie des écoliers » , ceux-ci reçoivent l’appréciation de leur travail: du rose pour les meilleurs, du jaune pour les moyens, du gris pour les autres (pp. 123-124). En ce temps de transition vers l’instruction primaire obligatoire (loi de 1914), les parents ne savent pas tous lire…

Un petit parallèle en passant, trouvé chez un autre de nos écrivains. Ecolier (il est né en 1903) quand d’Orbaix était maître, Georges Simenon a évoqué, dans Pédigrée, son milieu scolaire, ici catholique. L’enseignant assis sur une chaise très haute et son pupitre planté au bord de l’estrade se sont gravés dans la mémoire du gamin d’Outre-Meuse. Mais c’est aussi un lieu où « l’air sent la craie et l’eau sale du seau surmonté d’une serviette où les écoliers se lavent les mains » . D’une classe voisine, on entend les élèves scander en cadence la leçon: « L’ancienne Belgique était bordée au nord et à l’est par des marécages, à l’ouest par la mer, au sud… » Comme récompenses, frère Mansuy distribue lui aussi des bons points roses « ou mieux: une gomme à la violette » [2]. Des aspects communs et des variantes…
Ce qui ne risque pas de changer avec le temps, c’est assurément l’ironie qu’inspire aux professeurs le programme officiel. Le chapitre parodique que consacre Désiré-Joseph Debouck à ce « texte essentiel à relire » n’a pas pris une ride: « Magisters, Echevins, Inspecteurs, Ministres, prosternés dans la même dévotion devant ses dogmes révisables, s’inspirent journellement de l’Esprit du Programme, et, grâce à lui, réalisent des merveilles » (p. 71). L’importance accordée à la promenade dans la nature rapproche également les anciens instits de leurs lointains successeurs: « Il faut que tous sentent la terre, aient de l’herbe collée au dos et des feuilles dans la chevelure » (p. 135). La pédagogie mise en œuvre et conseillée dans Le don ne s’adresse pas qu’aux seules intelligences: « N’oublie pas que les cerveaux tiennent aux cœurs par des cordons magnétiques qui leur commandent: il faut encore que tu sois un marchand d’amour » (p. 54). Le bon magister est celui qui sait se faire enfant parmi les enfants: « Parle-leur simplement, en riant dans le jour; tes mots dessineront de jolies images sur l’écran neuf de leurs consciences » (p. 107).
A partir de second degré reviennent périodiquement les compositions (les contrôles ou les examens), « ramenant avec elles une épidémie de coliques obligatoires comme toutes les branches enseignées » (p. 119). Propos hyperbolique, bien sûr! En fin d’année, le rituel de la distribution des prix, en présence du Conseil communal, marque pour longtemps les jeunes esprits: « A l’appel de leur nom, qu’applaudit un orchestre triomphal, filles et garçons gravissent les marches de l’estrade, s’avancent le long du tapis vert, reçoivent d’une « autorité » paternelle et rouge les petits in-octavos de même couleur qui ont exactement le poids d’une année de travail » (p. 165) (les in-octavos sont des livres désignés par leur format).
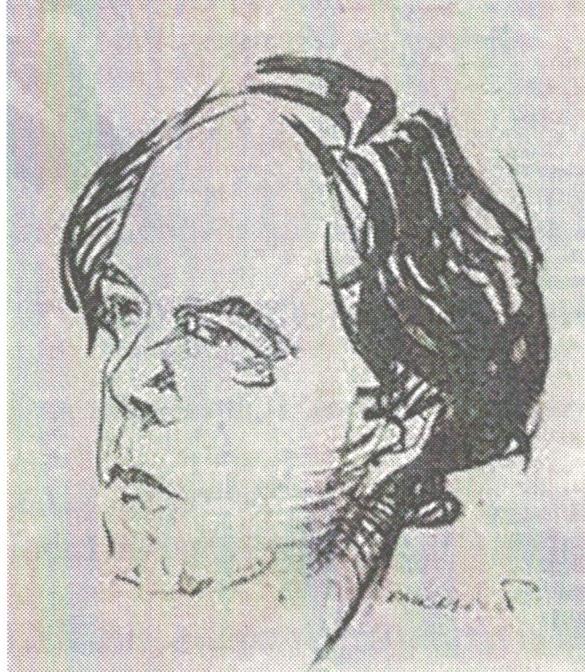
Les réalités que dépeint d’Orbaix sont cependant composites et ses pages loin de baigner toutes dans le bonheur d’instruire. Celui qui, le jour, a pour mission d’ouvrir au savoir des enfants pauvres chaussés de piètres galoches, qui aiment la bagarre et se ruent sur la soupe à midi, donne également des cours du soir à leurs pères ouvriers aussi mal débarbouillés. Les tâches sont nobles, ô combien! mais le découragement, souvent, l’emporte, attisé par le manque de reconnaissance sociale dont, déjà, souffre le métier. « Ne rions pas du pauvre magister, de celui que l’on croit pédant mais qui n’a, avec l’orgueil d’une science énorme, que la crainte d’une profonde ignorance! » Chaque matin, après avoir embrassé sa femme et ses enfants, il s’en va s’improviser tour à tour mathématicien, grammairien, écrivain, moraliste, physicien, naturaliste, historien, géographe, dessinateur, hygiéniste, musicien, gymnaste…: « Un homme qui, s’étant mis dans le crâne une encyclopédie à la portée des pauvres, partage encore son cœur comme un bon pain, et le donne, et miraculeusement le multiplie aux bouches des petits; un homme qu’en retour on paye d’affronts, vacarmes, quolibets, rancunes et moqueries, de toute cette menue monnaie qui roule par le monde et qu’on nomme l’ingratitude, un tel homme peut-il encore être un homme ? » (p. 62).
Le malaise dans la profession, lié aux lacunes de la formation, au sous-paiement, au délabrement des locaux et du matériel, affleure dans nombre d’écrits contemporains. Quand il y est question des instituteurs reviennent sans cesse les mots de vocation, de sacerdoce, d’abnégation, d’altruisme, d’idéal… ou encore de don [3]. Le titre de Désiré-Joseph, avec son double sens – le talent, le bienfait –, n’a pas été retenu fortuitement. A l’expression des complaintes alors générales, il ajoute une forme d’identification au Christ. Les références évangéliques, comme celle qui est faite à la multiplication des pains dans l’extrait ci-dessus, parsèment tout l’ouvrage. Aux points culminants, le sacrifice et les souffrances du magister renvoient à la Passion. Il aime ces petits d’hommes qui lui dressent une couronne d’épines sans savoir ce qu’ils font (pp. 25-26, 103…).
Est-ce le désenchantement, le sentiment de buter sur une impasse ou l’absence de perspectives à Saint-Gilles qui poussent Debouck, après un peu plus d’une dizaine d’années, à réorienter sa carrière ? En 1921, il réussit l’examen qui fait de lui un inspecteur cantonnal de l’enseignement officiel. Une fonction peu banale pour ce catholique ardent qui, dans son livre, déplore que « nul ne priera Dieu dans la maison scolaire d’où l’on a banni la prière » (p. 97)…
Peu auparavant, en 1919, d’Orbaix s’est marié (il aura trois enfants) et a fondé avec un autre jeune auteur, Alex Pasquier, la revue La Bataille littéraire, qui paraîtra jusqu’en 1924. Installé à Uccle, où une rue porte son nom, il enrichira son œuvre d’une bonne quinzaine de titres tout en couvrant l’actualité théâtrale pour le quotidien Le Soir. Il gardera toujours le contact avec le terrain scolaire, mais dans un rôle de supervision, loin des joies et des peines que lui procuraient ses ribambelles d’écoliers. A ceux-ci, dans les dernières pages du Don (pp. 177-179), à l’heure de quitter définitivement la classe, son tableau, son poêle roux et ses bancs-pupitres « vernis de lumière » , il adresse d’émouvants adieux qu’ils liront peut-être, plus tard, un jour:
« Emportez mon sourire et prenez mon image
Pour les temps où l’on a besoin de souvenirs » .
P.V.
[1] Désiré-Joseph d’ORBAIX, Le don du maître, Bruxelles, Samsa, 2020, 222 pp.
[2] Georges SIMENON, Pédigrée, 1948, 2è part., 5 et 7.
[3] On trouvera sur ce sujet des informations complémentaires dans mon article du 20/6/2020, Il y a cent ans, ma tante institutrice.

Notre papa (1914-1999) disait en parlant de son cache-poussière gris d’instituteur, que c’était son habit de forçat, un forçat mais heureux de l’être. Il a fait son école Normale à Malonne dont il avait stigmatisé l’austérité en créant une revue en un seul exemplaire, « les échos liés ». Ejecté de Malonne pour ce fait, il poursuivit son régendat à Bruxelles à Saint Thomas d’Aquin. C’est grâce au grammairien Joseph Hanse, membre du jury d’homologation qu’il obtint son diplôme de régent scientifique: » Je vais vous lire la dissertation de ce jeune homme et vous comprendrez pourquoi vous devez lui donner son diplôme! » Henry était un pur littéraire et son père lui avait dit: « puisque tu te débrouilles bien en français tu feras des études scientifiques ». Echaudés par les mathématiques pendant ses études, il en comprenait les difficultés chez ses élèves et proposait un enseignement « adapté » que l’on pouvait qualifier de miraculeux pour les cas difficiles.
J’aimeJ’aime
Merci pour ce témoignage. L’école d’hier ou d’avant-hier, jusqu’aux années ’60, tellement différente de l’actuelle, mériterait d’intéresser davantage les historiens.
J’aimeJ’aime